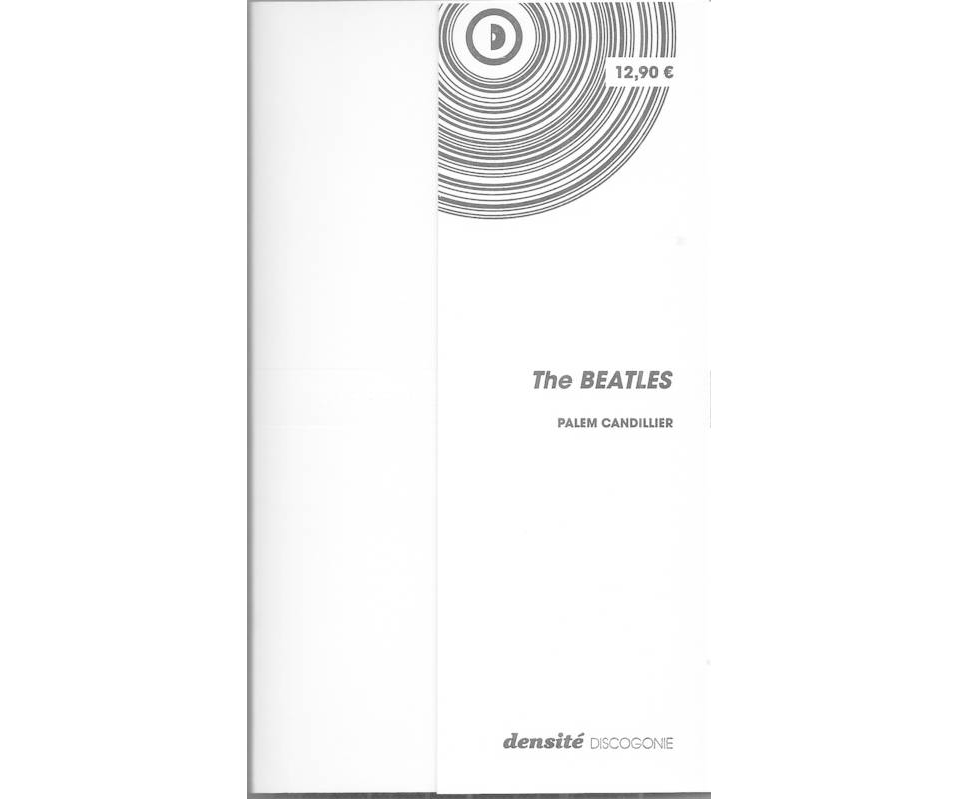Pourquoi après avoir écrit un livre sur Nirvana « In Utero », écrire un livre sur le double blanc des Beatles ?
Au tout début de mon histoire avec Discogonie, j’avais proposé à Hugues, l’éditeur, d’écrire sur un album solo de John Lennon ! On s’est ensuite plutôt orientés vers Nirvana mais l’idée de parler des Beatles a fait son chemin. On était d’accord que si les Fab Four devaient rentrer dans cette collection, ce serait d’une façon à la fois originale et ambitieuse, alors The Beatles s’est tout de suite imposé. Je pense qu’on était tous les deux excités à l’idée de s’attaquer à un aussi gros morceau. C’est un album que je trouvais, en plus, peu abordé dans le détail dans les livres consacrés au groupe, et les Beatles eux-mêmes sont assez laconiques sur cette période qui va pourtant occuper une année entière de leur carrière. Et puis cette pochette pose une question et crée un mystère que je voulais explorer.
Comment as-tu découvert le disque ?
Ce n’est pas le premier disque officiel des Beatles que j’ai eu entre les mains : j’ai plutôt commencé avec Let It Be et les coffrets Anthology à mes neuf ans. Mais j’ai découvert The Beatles à peine plus tard, j’en ai même retrouvé une copie K7 faite maison récemment dans mes affaires de gosse, donc c’est un disque qui s’est intégré très naturellement dans ma vie de fanboy précoce ! Je me souviens avoir été fasciné par ce disque, c’est un de ceux que j’écoutais le plus et sa durée exceptionnelle ne me rebutait pas du tout.
Peux-tu relater à quel moment et comment ce disque est conçu ?
The Beatles sort fin 1968 et a été principalement composé en Inde, pendant la retraite spirituelle du groupe au début de l’année. Les Fab Four sortent de 1967 complètement exténués et émotionnellement à fleur de peau, entre les hyper-succès de Sgt. Pepper’s ou de « All You Need Is Love » et des événements plus intimes et décisifs comme la mort de leur manager Brian Epstein, qui gérait notamment leur image et le développement de leur carrière. Ils tentent de se consoler et de se réinventer en réalisant le film expérimental Magical Mystery Tour , mais c’est un four, le premier de leur histoire ! Une fois l’aventure indienne terminée, ils se mettent au travail en juin 1968, trop heureux d’avoir « assez de matière pour deux albums » et d’être sortis de l’œil du cyclone pendant quelques semaines. Mais rien ne se passe comme prévu. Les Beatles peinent à communiquer entre eux et se dispersent, autant dans leurs propres chansons que dans des projets annexes. L’album blanc va mettre quatre mois à être enregistré et mixé. Il y aura des moments de création collective, qui seront salutaires et donneront de très belles chansons comme « Dear Prudence », mais chacun fait aussi ce qu’il veut, avec ou sans l’aide des autres. Tout le reste sera un casse-tête du même genre, qu’il s’agisse de trouver un titre, d’imaginer une pochette et même de lancer un single en guise de promotion. Il faut dire qu’ils viennent de créer leur label, Apple Corps, qui à part être un futur gouffre financier leur laisse le champ totalement libre.
Comment peut-on placer ce disque dans la discographie des Fab Fours ?
De mon point de vue, The Beatles fait le pont avec Revolver , sorti en 1966. Entre les deux, il y a une année entière de culture hippie, du psychédélisme et de chansons ou d’images qui font date, avec la pochette de Sgt. Pepper’s , « A Day In The Life », « Strawberry Fields » et toute cette phase colorée et baroque dans leur art. Mais Revolver et The Beatles ont en commun une façon d’écrire et surtout d’enregistrer très artisanale. On voit les coutures, on laisse les petites erreurs ou les hasards de montage, on fait du sampling avant l’heure, de « Tomorrow Never Knows » à « Revolution 9 ». Ça déborde, ça bave, ça joue roots. Je trouve que dans ces deux disques, on « sent » le studio d’enregistrement autour, il est utilisé comme un instrument à part entière, là où Sgt Pepper’s est plus léché mais plus convenu. Et le plus fou avec The Beatles , c’est que sa place paraît naturelle dans la discographie du groupe. On pense tous « ben oui, évidemment, le double album blanc ! » alors que l’affaire était loin d’être évidente et que sortir un double album était un pari à l’époque. Donc le LP a un statut affirmé et s’inscrit en même temps dans la droite lignée d’une façon de produire plutôt instinctive, brute. En fait il se situe surtout dans leur discographie par rapport à ce qu’il a bousculé : à côté, Sgt Pepper’s et Magical Mystery Tour ont presque l’air d’être des parenthèses. Ce n’est pas pour rien que, deux mois après la sortie de The Beatles , Paul incitera les autres à faire un autre album enregistré en conditions live avec le moins de retouches possibles, Let It Be .
Quelles ont été tes impressions à la première écoute ?
J’ai le souvenir, enfant, d’avoir tout de suite aimé les coins plutôt inattendus du disque. « The Continuing Story Of Bungalow Bill » et les chansons les plus naïves m’ennuyaient déjà. « Helter Skelter » me fascinait pour sa violence, « While My Guitar Gently Weeps » m’initiait au rock aérien que j’allais écouter plus tard avec Pink Floyd. J’entrais dans un autre monde que les autres albums n’ouvraient pas forcément. Quand je l’ai réécouté pour préparer le livre, la première chose qui m’a sauté aux oreilles, c’est la qualité d’écriture alors que beaucoup de morceaux sont finalement brouillons par rapport aux albums précédents. Même dans l’inachevé, les Beatles en avaient sous le pied et pouvaient passer d’une émotion à une autre au détour d’un couplet, j’en parle d’ailleurs pour « Martha My Dear », ou en pariant sur des arrangements minimalistes à l’extrême comme dans « Long, Long, Long ».
Est-ce que le fait que le groupe, dans ce disque, aborde plein de styles différents (rock, pop, blues et même parfois métal) a joué dans son succès et sa réputation selon toi ?
Complètement, car en plus d’être un double album, c’est un album sacrément dense, et ça n’aurait pas pu marcher aussi bien auprès du public si les quatre faces étaient sur le même ton ou dans la même énergie. N’importe lequel de leurs autres disques sont rasoir si vous imaginez qu’ils sont doublés : pas celui-ci, et c’est aussi pour cela que les Beatles eux-mêmes et beaucoup d’admirateurs sont incapables de faire le tri entre ces trente chansons pour faire album simple ! Le fait qu’il y ait autant de styles a aussi créé une interactivité avec The Beatles : vous pouvez quand même faire une sélection pour en créer une version 100% chansons naïves avec « Ob-La-Di, Ob-La-Da » et « Cry Baby Cry », une autre très rock à base de « Yer Blues » et « Birthday », une autre plus acoustique… Mais, si on veut creuser un peu, le résultat d’avoir pastiché ou de s’être approprié avec succès tous ces styles plutôt casse-gueule (music-hall, country, acid rock, comptine, soul), c’est que le « white album » est rempli d’émotions très différentes et parfois contradictoires. On traverse une palette de sensations et sentiments assez folle et j’aime croire qu’une part inconsciente de l’auditeur est fatalement attirée par ce mélange bordélique mais très psychologique.
A-t-il eu une influence sur ta propre musique ?
Oui, surtout pour le côté artisanal dont je parlais plus haut. J’adore cette approche dépouillée mais en même temps l’exploitation têtue qu’ils ont faite du studio. En fait je crois que c’est ce genre d’album qui m’a donné envie d’enregistrer, plus que d’écrire. Bizarre, non ?
Est-ce, selon toi, un disque marqué par son époque, notamment avec des morceaux comme « Revolution 1 » ?
The Beatles , c’est le début de la fin du groupe, et c’est en ça que les Fab Four sont au rendez-vous de leur époque : c’est aussi le début de la fin de la courte aventure hippie ! C’est déjà l’époque des émeutes et des révolutions à Paris, Prague, Londres, donc le peace & love est vite devenu combatif : « Street Fighting Man » chantent alors les Rolling Stones. Et pourtant, les Beatles ne répondent à leurs contemporains qu’avec « Revolution 1 » (et sa version électrique « Revolution » tout court), qui vaudra d’ailleurs à John Lennon une incompréhension de son public tellement le texte est tiède. Tous les membres sont généralement accaparés par leurs affaires privées, leurs projets musicaux ou le développement d’Apple Corps, qui était pourtant lancée comme une utopie pour mettre des moyens à disposition des artistes inconnus mais qui va vite les diviser. Alors disons plutôt que The Beatles est bien dans son époque, mais pas pour des raisons flagrantes, pas pour les textes ni même la musique quelque part ! Il faut rappeler que certains styles pastichés sont has-been, comme le ragtime de « Honey Pie ». Il y a plutôt un parallèle qui se construit entre le délitement de l’unité des Fab Four et celui de l’optimisme des sixties, mais aussi un côté moderne avec cette anti-pochette qui rejoint l’avant-garde artistique de l’époque. The Beatles est un peu une bulle en fait : elle est là, on voit le monde à travers, mais elle reste fermée et c’est ce qui fait sa beauté.
Quelle est l’influence des personnes extérieures au groupe, comme Yoko Ono, sur ce disque ?
Les Beatles vont partager leur retraite spirituelle en Inde avec des collègues, comme Mike Love des Beach Boys ou Donovan, qui vont influencer de près ou de loin l’écriture des chansons. Yoko Ono va bien sûr jouer un rôle important auprès de John, car c’est la femme créative et proactive que le chanteur rêvait de rencontrer depuis toujours et avec qui la co-influence artistique ne fait que commencer. Elle va le libérer de sa propre autocensure et l’aider à mûrir. Mais le plus important, c’est que les Beatles ont besoin d’avoir ces personnes extérieures pour réussir leur double album : de nouveaux ingénieurs du son qui vont apporter une autre dimension aux titres, beaucoup d’invités comme Eric Clapton sur « While My Guitar Gently Weeps », des ensembles orchestraux, des chœurs… Bon pour un disque que je défends comme très « roots », c’est finalement très produit avec tous ces intervenants, mais ils arrivent à chaque fois au bon moment, ce sont des guests pertinents qui apportent quelque chose sans voler la vedette.
https://www.youtube.com/watch?v=YEMEAxlYL04
Tu consacres un chapitre à Charles Manson, comme étant la face sombre du disque, pourquoi ?
Charles Manson incarne l’utopie hippie qui dérape et le rêve américain qui s’assombrit. En 1969, il commandite un certain nombre de meurtres en Californie, que les fidèles de sa secte, appelée la Famille, se chargent d’accomplir avec autant de brutalité que de maladresse. On compte l’actrice Sharon Tate, alors enceinte, parmi les victimes. Manson s’est déclaré avoir été influencé entre autres par The Beatles , il était persuadé que le groupe y avait glissé des révélations sur une prochaine apocalypse et des instructions pour y survivre ! C’est « Helter Skelter » qui l’aurait inspiré en particulier, et comme c’est le morceau le plus violent de l’album blanc, c’est assez facile d’y voir une sorte d’astre noir, de face sombre dont l’héritage n’a pas seulement été musical, puisqu’on pense qu’il annonce le hard et le heavy metal, mais aussi tristement historique. C’était malgré tout délicat pour moi d’évoquer toute cette affaire, et j’ai hésité sur la place à lui donner dans le livre. D’un côté, Charles Manson a associé l’album blanc à des actes tellement horribles qu’on ne peut qu’avoir le réflexe de le mettre à distance, très loin de la musique et de la sensibilité totalement positive des Beatles. D’un autre côté, ces meurtres font tellement partie de l’impact de The Beatles que je ne pouvais pas ne pas en parler. L’important pour moi a été de ne pas sombrer dans le sensationnalisme et de raconter, posément et sans voyeurisme, les faits, et d’essayer de faire le point sur ce rapport entre des crimes et de la musique.
Quels sont les morceaux que tu retiens ?
Est-ce que c’est une question-piège pour savoir quels morceaux je garderais pour faire un album simple ? A vrai dire, ça change tout le temps. J’ai vraiment développé une tendresse pour les moins connus, comme « Long, Long, Long », ou « Rocky Raccoon », qui est un peu débile mais bien écrit. J’ai aussi toujours été super fan de « Glass Onion » et je trouve « Dear Prudence » spectaculaire à tous les niveaux : l’écriture, les arrangements, le son…
Penses-tu que ce disque a toujours une influence sur les jeunes musiciens ?
Je ne sais pas, j’espère que la réédition des cinquante ans a fait découvrir cette musique à des musiciens plus jeunes, mais je pense que The Beatles a une influence plutôt culturelle aujourd’hui. C’est un disque qui a défini la notion de double album, j’en suis persuadé, et qui a donné le ton sur beaucoup de plans : l’ambition musicale, le pastiche, la reprise, le sampling , le packaging… Les jeunes musiciens ne l’identifient sans doute pas immédiatement, mais c’est un LP à qui on doit beaucoup.
Peux-tu présenter ton éditeur ?
Je travaille avec les éditions Densité, dirigées et fondées par Hugues qui y a créé la collection Discogonie, dans laquelle chaque livre aborde un album mythique du rock, de la pop ou de la chanson, de Dominique A à Rage Against The Machine en passant par The Cure, The Smiths ou Alain Bashung. C’est une collection qui fait parler d’elle depuis quelques années et dans laquelle j’ai la chance d’avoir pour collègues des spécialistes et des journalistes musicaux incontournables comme Pierre Lemarchand, Philippe Gonin ou Guillaume Belhomme.
Quels sont tes projets d’écriture ?
J’évite de trop en parler tant que ça n’est pas terminé, mais je travaille en ce moment sur deux autres livres pour Discogonie, l’un côté nord de l’Angleterre, l’autre sur un groupe français. J’ai quelques autres projets, notamment un John Lennon qui attend son heure et qui sera sans doute remodelé pour en faire autre chose, et j’aimerais beaucoup passer à la fiction, mais je me donne du temps pour bien faire les choses.