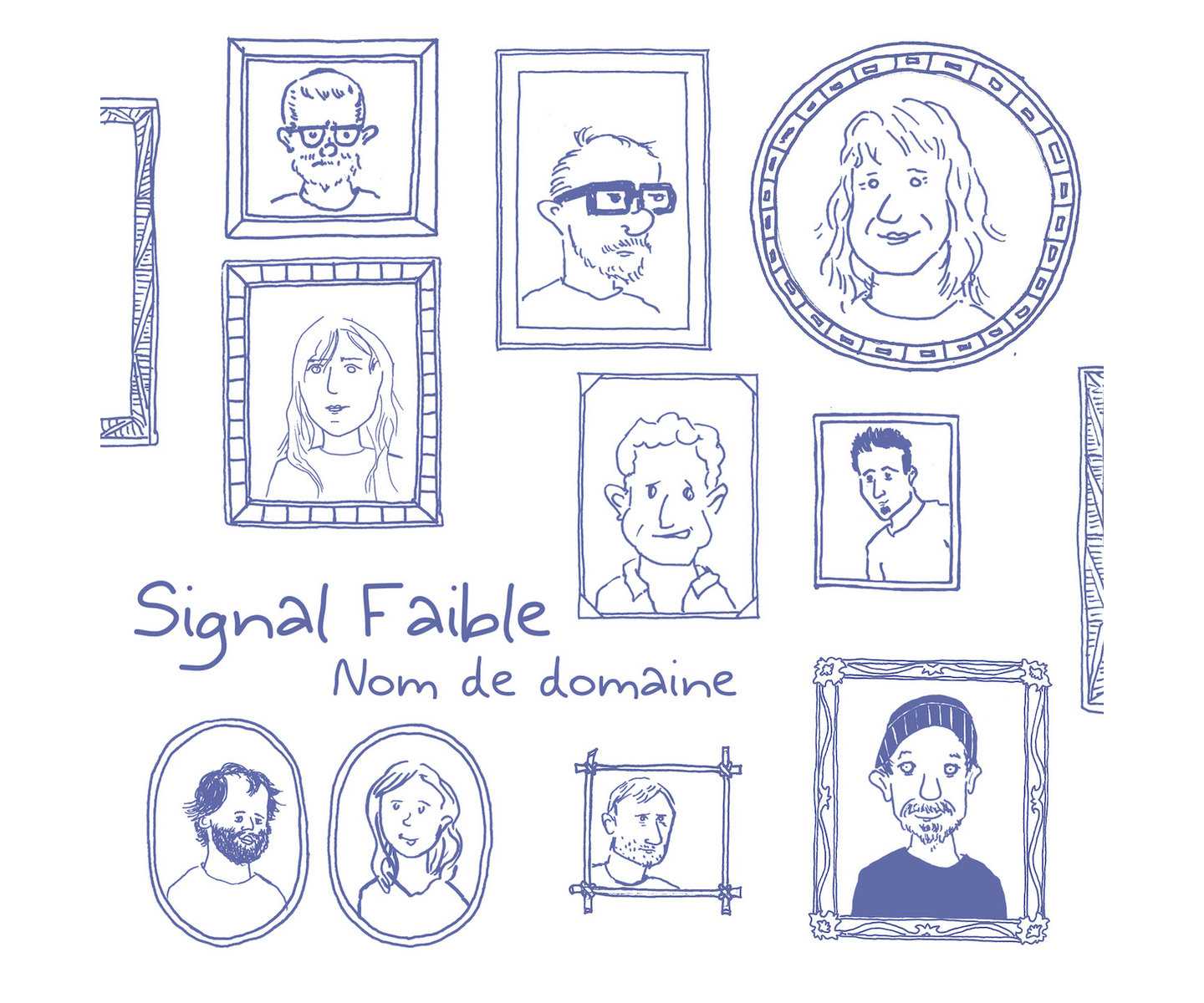Il y a deux ans, tu sortais un nouvel album avec Fontaine Wallace et là tu reviens avec Signal Faible. Que s’est -il passé ?
De bonnes choses : le deuxième album de Fontaine Wallace été suivi de pas mal de concerts. Puis je me suis interrogé sur la suite, alors que les autres membres du groupe étaient absorbés par leurs propres projets et envies. La question n’était pas d’arrêter le groupe mais de réfléchir à d’autres formats. Pour moi, cela devait obligatoirement passer par un collectif. Comment monter un collectif plus large, plus ouvert, plus collaboratif et un peu informel ? J’avais quelques chansons. J’en ai parlé autour de moi et rapidement ça a intéressé des gens. L’idée était lancée, même si au début je ne savais pas où j’allais, combien il y aurait de personnes, si un label serait intéressé… Je n’en savais rien, je voulais juste collaborer avec d’autres musiciens.
Tu as appelé ce groupe Signal Faible et l’album Nom de domaine. C’est une façon de te cacher ? Tu aurais pu appeler ça Nicolas Falez, tout simplement.
J’admire beaucoup les gens qui se lancent en solo et qui savent ce qu’ils veulent des musiciens avec qui ils travaillent. Mais ce que je préfère, c’est de me faire bousculer, être emmené ailleurs. Les musiciennes et musiciens qui ont répondu à l’invitation ont beaucoup apporté en modifiant ou en détournant des choses que j’avais apportées au départ.
Justement le disque s’appelle Nom de domaine, ce qui est contradictoire avec ton propos : ça fait penser à internet alors que ta musique est loin de l’électronique. On a l’impression, encore, que tu te caches et que tu veux brouiller les pistes.
Il y a un peu de ça. Le nom, que j’aime beaucoup, fait référence à internet mais aussi à d’autres choses comme l’espace, une prairie, un champ, un lieu réel ou imaginaire. Est-ce que je me cache ? Oui, même si c’est un peu paradoxal sur ce disque parce j’en suis l’initiateur et ce sont mes chansons. C’est une espèce de jeu de piste : qui a fait quoi ? Qui joue et chante quoi ? C’est peut être la dimension ludique du projet.
A l’écoute de ce disque, on retrouve tes caractéristiques : les mélodies, les textes, l’ambiance générale…
J’espère. Je revendique complètement les trois albums de Superflu, les deux de Fontaine Wallace et celui de Signal Faible. Je n’ai pas l’impression de prendre mes distances ou d’occulter certaines choses. Je joue sur scène des chansons de mes anciens groupes et je continue à tirer le fil de ce que je faisais il y a 25 ans. Bien sûr, j’ai vieilli, j’ai grandi, j’ai rencontré des gens mais artistiquement c’est le même sillon.
Comment as-tu eu l’idée d’appeler tous ces gens ?
En écoutant leurs albums et en allant à leurs concerts. On a l’habitude de dire que la musique indé est un secteur sinistré économiquement et c’est vrai mais il ne l’est pas du tout artistiquement. Tous ces gens font de la musique dans laquelle je me reconnais, c’était tentant de les inviter. Certains ne pouvaient pas participer, d’autres ont dû s’organiser mais j’ai senti qu’il y avait une envie. Certains sont de vieilles connaissances, comme Christian Quermalet qui a collaboré à tous les albums de Superflu. Mais à l’inverse, je ne connaissais pas personnellement Lonny, dont j’ai apprécié le premier album. Il y a aussi de l’admiration ancienne comme celle que je voue à Silvain Vanot. Et puis Thomas Van Cottom (Cabane), Julie Bonnie, Arlt, Orso-Jesenska, Nesles… tous les autres.
Tu n’avais pas peur du côté « All Star band de la pop indie française » ?
Non, parce que je pense que personne ici n’utilise le terme « star » (rires). On est tous conscient du périmètre modeste dans lequel on évolue. Ça évacue totalement l’idée de star. On a d’abord parlé musique avant de savoir s’il y aurait un label. On n’a pas parlé d’argent et ça, c’était bien !
Tu n’avais pas peur que cela parte dans tous les sens avec autant de monde ?
J’en avais envie. J’ai reçu plein de choses, ça circulait … On a beaucoup travaillé par correspondance, par échange de fichiers… J’étais l’organisateur et j’étais content que ça parte dans tous les sens. Je n’avais aucun plan avant, même musicalement. Je savais seulement que ce serait folk, collectif, que j’enregistrerais beaucoup par moi-même donc avec une dimension artisanale. Le but était surtout de laisser une grande liberté aux gens.
Tu as fait comment pour enregistrer ?
Pour des raisons de disponibilités et de géographie, beaucoup de choses ont été enregistrées à la maison. Pour des raisons économiques aussi. J’ai la chance de pouvoir passer du temps dans une maison en Mayenne, où j’ai pu travailler pour le disque. La technologie a permis de se passer du studio sauf pour les deux batteries, jouées par Christian Quermalet, sur « Pizza » et « Bocage ».
Tu as sur ton disque l’ancien clavier de Mercury Rev, Adam Snyder, comment l’as-tu rencontré ?
En 1998, avec Superflu nous avons joué au festival des Inrocks le même soir que Mercury Rev. Juste après, ils nous ont proposé leur première partie sur leur tournée française. J’ai rencontré Adam à ce moment-là et on s’est vraiment bien entendu. J’ai toujours gardé le contact avec lui. On s’est revu régulièrement que ce soit en France ou aux USA. Là, on ne s’est pas vu depuis des années mais il était évident qu’il devait participer au disque. Il a enregistré le piano de « Soustraction » chez lui. Je suis très heureux de faire vivre cette rencontre d’il y a 25 ans à travers cette chanson.
Tu avais quoi en tête quand tu as enregistré ?
J’ai beaucoup réécouté Damien Jurado, Hayden (un artiste canadien que je vénère), Mount Eerie… Je reste aussi connecté à mes héros du folk américain des années 90 : Will Oldham, Bill Callahan, David Berman des Silver Jews. Je suis toujours en communion avec ce qu’ils m’ont apporté. Ils m’ont appris l’artisanat et à aimer les choses pas trop lisses dans une production. J’essaye de progresser, de ne pas toujours faire la même chose mais aussi de garder cette spontanéité et cette fraîcheur. J’ai aimé cette idée dans le folk alternatif des années 80 et 90 : le DIY, l’idée que l’émotion doit toujours prendre le pas sur la technologie.
Ton disque a un côté « rural » avec ces photos de toi dans la campagne. On a l’impression que tu as besoin d’espace, de campagne et de soleil ?
Ce n’est pas une pose chez moi. J’aime Paris mais je passe de plus en plus de temps à la campagne en Mayenne. Je me sens de plus en plus en phase avec la nature. Le disque a été conçu et enregistré, en partie là-bas.
Ce n’est pas un disque urbain ?
C’est vrai. Dans Fontaine Wallace il y avait pas mal de paysages urbains (d’ailleurs, le nom du groupe est une référence parisienne). Mais maintenant ce contre-champ est important pour moi. Je me dis que juste avec un micro, deux guitares, un ampli et un ordi tu peux faire un disque à la campagne. Ça s’entend sur l’album, je pense.
Quels sont tes modèles d’écriture ? On pourrait penser à un Ray Davies qui racontait des scénettes…
(Silence) C’est mon sixième album et j’essaie d’éviter la répétition. L’un des outils pour ça, c’est le lexique, le vocabulaire : de faire entrer des mots qui ne sont pas évidents dans la chanson. Par exemple, j’ai le mot « seum » dans la chanson « Bocage ». Il y a quelques années, je ne l’aurais pas écrit « seum » dans une chanson. De toute façon le mot n’existait pas encore (rires). J’ai l’impression qu’une chanson doit « respirer » et pour ça j’essaie d’y faire entrer de l’étrange, de la bizarrerie.
Sur « Bocage », tu chantes que tu quittes « la colline du crack » pour la route. C’est une façon de dire, « je m’enfuis » ?
Quand je dis que j’essaye de faire entrer des mots pas évident dans les textes, « crack » en fait partie. J’aime quand ça grince et que ça n’est pas lisse.
Il y a « Pizza » quand tu chantes « tu n’as pas vu le temps tourner ». C’est un peu rude parce que tu n’es pas très âgé.
Quand même (rires) ! C’est une chanson de rupture sur un couple qui se fracture autour d’une pizza. Ça a un côté cinématographique. Je voulais raconter quelque chose de triste mais avec un peu de recul, je chante le nom des pizzas par exemple : « Brooklyn » et « James Dean ». « Tu n’as pas vu le temps tourner », dans la chanson, c’est une façon de dire à l’autre que c’est fini.
« Billy Cheval », ne serait pas une réponse à « 25 ans », la chanson de Superflu, où tu chantais que le temps passe vite. Là, tu parles d’un jouet avec ce cheval à bascule.
Tu as raison de faire le parallèle. « 25 ans » c’était le temps qui passe et « Billy Cheval », c’est un peu la même chose ou comment faire pour garder l’enfant ou l’adolescent qui est en soi. Rien que de faire de la musique est déjà une réponse à ça.
Pour la promotion du disque, tu as choisi de faire beaucoup de clips ?
Oui, c’est une idée de Jean-Charles, le patron de Microcultures. Quand je lui ai parlé de ce format collectif et collaboratif, il m’a proposé de feuilletonner la sortie, avec une chaque mois une chanson accompagnée d’un clip. C’était quand même un petit défi… et sans argent ! J’ai aussitôt pensé au VHS. J’ai cherché et trouvé une caméra et des cassettes sur internet. Le grain de la VHS amène quelque chose. C’était intéressant artistiquement. Il fallait manier ce format un peu daté mais ça ouvre sur un imaginaire. J’ai aussi utilisé du Super 8. Je me suis bien amusé.
Là encore c’est très nostalgique !
Ce n’est pas ça l’idée. C’était un challenge de savoir si j’allais pouvoir travailler en analogique. Ce sont des formats qui font appel à des objets ludiques comme des cassettes ou des projecteurs. Il y avait un côté tactile et artisanal qui me plaisait. Par exemple, une pellicule Super 8 dure trois minutes et on ne sait pas ce qu’on a comme images avant de l’avoir développée. Cela crée des gestes et des façons de faire assez stimulants.
L’album sort encore chez Microcultures ?
J’en suis ravi. C’est compliqué de trouver un label aujourd’hui. Je vois dans leur façon de faire le reflet de la mienne. Ils essaient de trouver tous les moyens pour sortir des albums dans un monde où l’on ne vend plus de disques. L’idée de la pop folk indé est très marginale mais il y a des pépites dans leur catalogue. J’aime l’idée que l’on défende les mêmes envies, les mêmes communautés. Cela crée une proximité qui me plait bien.
Ça se passe comment sur scène ?
Faire un disque à 17 ça compromet l’idée de réunir tout le monde sur scène ! Je rêve quand même d’un lieu qui nous accueillerait tous pour une résidence suivie d’un concert. En attendant, l’idée était de prendre une direction radicalement différente pour la scène. Actuellement, je tourne en un duo violoncelle, guitare. Sachant qu’il n’y a pas une note de violoncelle sur le disque, on est parti d’une page blanche pour arranger les morceaux. Les premiers concerts se sont super bien passés et d’autres arrivent en 2024. J’espère en faire beaucoup parce que la formule se prête vraiment bien aux chansons de l’album.
Quels sont tes projets : tu vas continuer de travailler de cette façon ?
Ce n’était pas défini au moment où j’ai lancé le projet ! J’étais tellement content du résultat que j’ai donné un nom à ce projet, Signal Faible, ce qui me donne la possibilité de prolonger l’histoire mais je ne sais pas s’il y aura une suite. Je ne sais pas comment, ni avec qui. L’album vient de sortir, j’ai plein de retours positifs et pour l’instant le but est de faire vivre le disque sur scène. Rien n’est impossible et rien n’est interdit !
Pourrais-tu organiser un concert qui rassemblerait des musiciens de tes trois groupes : Superflu, Fontaine Wallace et Signal Faible ?
Pour plein de raisons c’est difficilement envisageable. Mais pour la première fois je joue en concert des chansons de Superflu et de Fontaine Wallace, en plus de celles de Signal Faible. C’est très important pour moi de faire vivre ces répertoires. Certaines chansons n’ont pas été jouées depuis 20 ans. Mais tout ça a un lien et a sa place dans les mêmes concerts.
Avec Signal Faible, tu as donc retrouvé une forme de liberté artistique ?
(Silence) Je ne vois pas le groupe comme une privation de liberté… sinon je n’aurais pas enchaîné 35 ans de groupes ! Pour moi c’est une utopie collective. Une utopie avec ses limites et ses échecs, comme toute utopie. Là, c’est vrai qu’avec ce collectif et cette formule scénique, je n’ai pas de gêne et de culpabilité de chanter des chansons de mes anciens groupes. C’est une façon de suivre un fil qui relie le passé au présent.
Tout ça reste tes chansons !
Oui, je les ai écrites mais ce que m’ont appris ces années et les retours du public, c’est que ce ne sont plus mes titres mais ceux des gens qui m’écoutent, qui vont me voir en concert. Que l’on vienne me voir aujourd’hui pour me parler des chansons du premier album de Superflu, c’est touchant et réconfortant.
Le mot de la fin !
On vit dans une époque qui n’est pas légère pour plein de raisons et je défends l’idée que la musique, et l’art en général, ont du sens dans ces moments-là. L’art n’est pas anecdotique ou bourgeois. C’est une façon de résister à la barbarie, d’affirmer que le chaos peut être joyeux et libérateur.
https://microcultures.bandcamp.com/album/nom-de-domaine