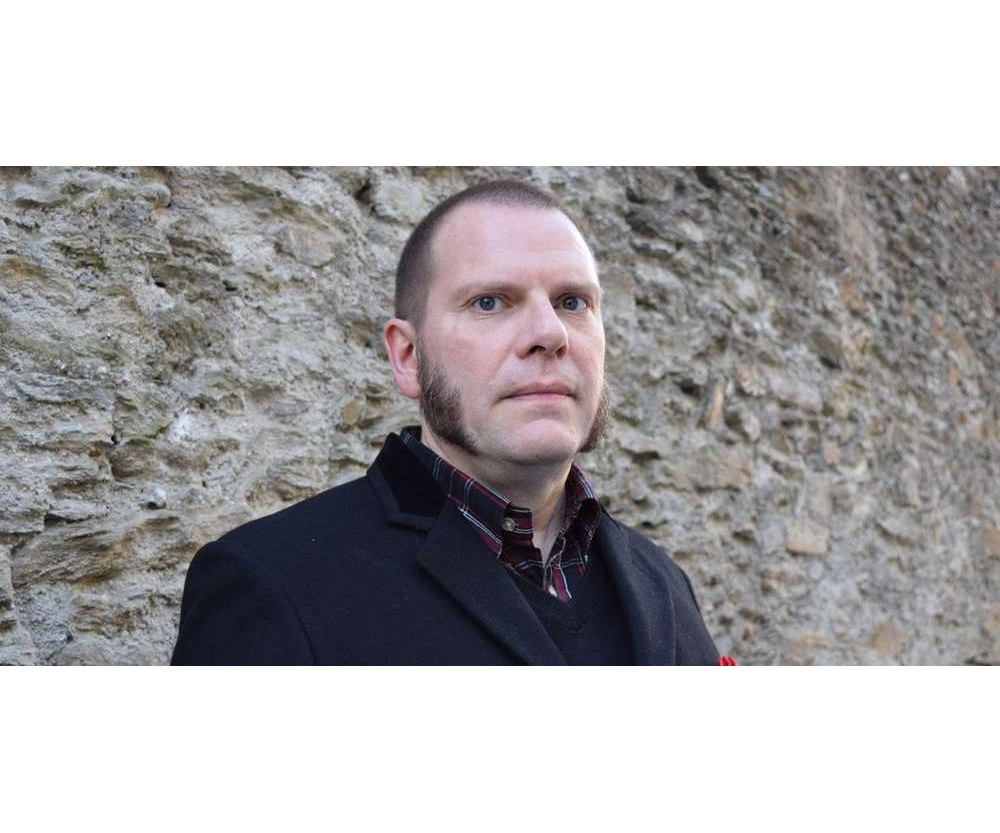Les sous-cultures, c’est quelque chose qui est lié à un âge ou à une époque dans la vie ? Elles sont également liées aux années 50-60 avec la découverte de l’adolescence ?
La définition courante de la sous-culture dit qu’il s’agit d’une culture, revendiquée ou cachée, partagée par un groupe d’individus, se différenciant ainsi des cultures plus larges auxquelles ils appartiennent.
Selon Ken Gelder, « les membres d’une subculture se distinguent de la norme générale de par leurs apparences, de leurs actions, de leurs comportements, de leurs idées, de leur mode de vie… Ils constituent un (sous-)univers (culturel) au sein d’un univers (culturel) plus vaste [1]. » Le même auteur identifie six clés de reconnaissance d’une sous-culture : des relations négatives avec le travail ; des relations négatives ou ambiguës avec la société de classes ; une référence à des territoires, des espaces publics ; une appartenance des individus en dehors de la famille ou du foyer domestique ; une démarcation par des styles excentriques ou exagérés ; un refus de la banalité de la vie ordinaire et de la massification. On remarquera qu’il n’y a pas de référence à l’âge parmi ces six clés de reconnaissance d’une sous-culture. On peut donc être un vieil hippy, un vieux punk ou un vieux skin !
Néanmoins il est vrai que la notion de sous-culture peut être reliée, du point de vue de l’engagement, à l’adolescence, et, plus précisément, si l’on considère l’adolescence comme une période de construction essentiellement physique et biologique, à la notion de jeunesse, plutôt comprise comme une construction identitaire, sociale et culturelle. Au regard de la sociologie, la population des 15-25 symbolise le mieux cette période sociale de l’individu en devenir. À partir de 15 ans, l’on dispose d’une plus grande autonomie pour affirmer ses propres goûts en dehors de l’accord parental. Dans ce cadre, la consommation d’objets porteurs de significations culturelles et personnelles fera partie intégrante de cette quête d’identité liée à la jeunesse et s’effectuer dans un désir de ressemblance aux pairs et de différenciation envers ce qui est extérieur au groupe.
C’est donc à la fin de la seconde guerre mondiale qu’apparaîtra la jeunesse comme catégorie sociale spécifique, autonome, consciente d’elle-même et dotée de ses propres références culturelles, via la consommation de musiques et de vêtements faisant office de marqueurs générationnels. Concernant la musique, lui étant entièrement consacré, le rock’n’roll qui émergera aux États-Unis au milieu des années 50 en même temps que la figure du tennager, sera la musique de la jeunesse, lui procurant une sorte de conscience de classe. Concernant les vêtements, ceux-ci communiquaient auparavant l’appartenance à une caste, à une classe, à un sexe. Ils vont désormais informer de l’âge, et, avec l’apparition des « looks », ils vont aussi être vecteurs de significations subculturelles.
S’il y a un pays où ces looks vont particulièrement faire florès, c’est bien en Angleterre où apparaîtront et se succéderont une grande variété de styles issue de la rue et adossée à des courants musicaux particuliers. Toutes ces sous-cultures locales vont conférer une dimension esthétique originale à des musiques produites hors de leur sol. À commencer par les teddy boys qui camperont la première grande subculture britannique d’après-guerre. Lorsqu’ils adopteront le rock’n’roll, ils donneront à ce son venu des États-Unis une allure, une apparence qui surprendront les vedettes américaines en tournée. Ted Polhemus écrira : « lorsque Bill Haley et d’autres visitèrent la Grande-Bretagne, ils furent suffoqués par ce qu’ils y virent ! ». « D’un point de vue américain, tout cela était très déroutant. Les tenues des teddy boys britanniques ne ressemblaient en rien, même de loin, à la vision que lesdits américains avaient du rock’n’roll […] rien d’équivalent n’avait jamais existé aux États-Unis. Tant en ce qui concerne le look que la façon de danser. [2] » À la suite des teddy boys, les mods, les skins, les punks… tous viendront apporter une dimension esthétique aux courants musicaux qu’ils adopteront.
Cette remarquable faculté des jeunes britanniques à créer des styles originaux, à extérioriser ainsi des identités collectives distinctives, constituera un phénomène social majeur et sera étudié en tant que tel par des chercheurs en sciences sociales affiliés au Centre for Contempory Cultural Studies de Birmingham créé en 1964. Les cultural studies forment alors un courant de recherche portant attention aux cultures populaires, minoritaires, contestataires…
L’approche de ces chercheurs vis-à-vis des sous-cultures sera original sur deux point. D’une part la participation sous-culturelle ne sera plus seulement considérée comme une déviance, mais comme une forme de résistance. D’autre part, le « mythe d’une culture juvénile transclassiste [3] » sera remis en cause : au-delà d’un simple conflit générationnel, le phénomène subculturel sera compris comme résultant d’un conflit de classe.
Comment se positionnaient les sous-cultures par rapport au système de classes anglais ?
Des teddy boys aux punks, les sous-cultures produisent des styles qui ne sont pas seulement extravagants mais aussi perturbants : ils posent des défis à la société anglaise en exprimant, symboliquement, une contestation de l’ordre social.
Les teddy boys surprendront les américains par leur allure mais surtout, ils choqueront la bienséance britannique car, pour la première fois, en ce pays, des jeunes issus de la classe ouvrière vont s’affranchir de l’influence de leurs parents et de la société en récupérant un style « d’en haut » qui ne leur était pas destiné. Les « teds » vont en effet construire leur style vestimentaire en s’appropriant et détournant le style edwardian d’inspiration aristocratique et initialement réservé à l’élite. Ce faisant, ils opéreront les premiers, bien avant les punks, une démarche transgressive dans la mesure où, dans une société de classes, l’appropriation de signes de la classe dominante constitue une provocation symbolique. En cela, ils incarneront une forme de résistance au conformisme de classes.
Les mods vont également se jouer des codes vestimentaires comme marqueurs sociaux et rendre confus les délimitations de classes en s’offrant la satisfaction d’être mieux habillés que leur patron. En cherchant à surpasser par leur élégance les classes supérieures elles-mêmes, en s’appropriant indûment les signes extérieurs d’un prestige sociale, ils incarneront aussi une résistance au conformisme de classes par leur volonté de se démarquer, au moins symboliquement, de leur origine sociale. Plus largement, par leur obsession élitiste de la distinction, ils s’opposeront à l’idée même de conformisme, qu’il s’agisse du conformisme de masse comme celui de leur propre milieu. Car pour les mods, conformément à leur système de compétition interne distinguant les leaders (les faces) des suiveurs (les tickets), il ne s’agit pas seulement d’être bien habillé comme les autres mods, mais d’être mieux habillé encore.
Les skins, je l’ai dit, vont aller à l’encontre de cette démarche consistant à travestir son origine sociale et camperont, en réaction, un style affirmant crânement leur appartenance à la classe ouvrière. Ils illustreront ainsi une résistance de classe, non pas seulement envers les mods, mais aussi à rebours des discours politiques dominants de l’époque qui prophétisaient la disparition des classes sociales. C’est plus précisément la classe ouvrière qui, selon ces discours, était appelée à disparaître, « victime » de son embourgeoisement progressif.
Tu parlais précédemment du phénomène subculturel comme résultant d’un conflit de classe…
Les chercheurs britanniques que j’évoquais précédemment chercheront à comprendre ce qu’expriment, au fond, toutes ces subcultures juvéniles, via l’interprétation de leurs formes stylistiques.
Pour commencer, ils établiront un lien entre la destructuration de la communauté ouvrière anglaises de l’après-guerre et l’émergence concomitante, au sein de cette communauté, de toutes ces subcultures.
Le constat de départ est donc celui d’une crise de reproduction du monde ouvrier, monde alors en proie à de multiples changements socio-économiques qui remodèlent et déstabilisent son identité entraînant une rupture dans la transmission symbolique entre parents et enfants des classes populaires, lesquels, pour le dire ainsi, ne savent plus à quelle classe se vouer. Pour Phil Cohen, répondant aux incertitudes identitaires des jeunes de milieux populaires, « la fonction latente des subcultures est là : exprimer et résoudre, mais ’’magiquement’’, les contradictions qui demeurent masquées ou sans solution dans la culture des parents ». Celle-ci se trouvant tiraillée « au niveau idéologique entre le puritanisme ouvrier traditionnel et le nouvel hédonisme de la consommation, au niveau économique entre un futur comme membre d’une élite socialement mobile ou comme composante du nouveau lumpenprolétariat. [4] » Les subcultures symboliseraient, dans leurs différents registres, l’une ou l’autre de ces options alternatives. Ainsi des mods qui s’imaginent en tant que futurs membres de cet élite socialement mobile et des skins qui se voient en tant que composante du nouveau lumpenprolétariat. Les premiers reflètent l’image hédoniste du consommateur de l’abondance. Ils se projettent vers l’avenir avec confiance, explorent la mobilité ascendante avec assurance, calquent déjà leurs goûts sur ceux dont ils rêvent de partager l’existence. À l’inverse, les skinheads rejettent cet hédonisme jugé contraire aux valeurs de la classe ouvrière. Ils vont se réfugier vers un passé imaginaire et fétichiser leur leur position de classe via leur style vestimentaire. Parallèlement, ils vont explorer le territoire du lumpenprolétariat et calquer leurs goûts sur ceux vis-à-vis desquels ils ressentent une « affinité émotionnelle » basée sur la sensation d’occuper le même « lumpen-statut [5] », à savoir les immigrés jamaïcains.
À l’image quelque peu mythique du prolétaire britannique qu’ils veulent incarner, les skinheads viendront superposer des éléments directement empruntés à la communauté antillaise, et plus particulièrement à la sous-culture délinquante, réelle ou fantasmée, des rude boys, créant un style original, à la frontière de deux univers, apparemment difficilement conciliables : celui, organisé, de la classe ouvrière, qu’ils regardent avec nostalgie mais dont ils redoutent la soumission et la disparition, et celui dérégulé du lumpenprolétariat qu’ils voient avec une certaine fascination et dont ils admirent l’insoumission et la vitalité. Le skin parviendra de la sorte, en conjuguant ces deux univers, à camper cette image de prolo un peu voyou, à la fois dans la tradition et dans l’insubordination.
Et les cheveux courts ?
Comme leur nom l’indique, les skinheads sont évidemment associés aux cheveux courts. Le crâne rasé, qui symbolise un engagement radical et qui est aussi la marque des bannis, participe de l’image inquiétante, martiale et menaçante du skin. Pour qui devient skin, le rasage de crâne, le passage à la tondeuse peut s’apparenter à un rite de passage, à une cérémonie initiatique marquant l’accès à un nouveau groupe d’appartenance.
Si le terme skinhead focalise l’attention sur cet élément distinctif de la physionomie du skin, à l’origine, tous les crânes n’étaient pas tondus et le seul fait de porter des boots, indépendamment de la coupe de cheveux, pouvait suffire à se faire qualifier de skin.
Il a été dit que les skinheads affectionnaient cette coupe courte parce qu’elle ne coûtait pas cher, parce qu’ils voulaient signifier ainsi leur rejet des hippies, pour éviter aussi d’être saisi par les cheveux par les flics à cheval… Il est vrai qu’une telle coupe était peu onéreuse et, sans être skin, beaucoup de jeunes de la classe ouvrière la portaient pour des raisons d’hygiène et de sécurité au travail. En cela, les cheveux courts étaient plutôt favorablement accueillis par les parents et les employeurs. Il est vrai aussi que cette coupe courte les démarquait nettement des hippies. Soit dit en passant, c’est tout « l’uniforme » skinhead, bien stricte, communiquant comme qualités désirables la dureté, la masculinité et l’identité prolétarienne qui offre un contraste total avec le look hippie. Néanmoins, le style skinhead ne s’est pas construit en opposition au style hippie puisqu’il lui est antérieur. « Dès 1964, des gamins qui portaient des rangers et des cheveux ras traînaient dans le milieu mod. […] Toutes les conneries peace and love ne sont arrivées que trois ans plus tard [6] ». Si les skinheads ont bien manifesté un rejet du mouvement hippie, ils ne sont pas nés en réaction au mouvement hippie.
Question cheveux, il faut aussi mentionner l’influence des chanteurs jamaïcains qui affectionnaient les coupes courtes avec une raie bien dessinée sur le côté et qui seront imités en cela par les skinheads. La « boule à zéro » sera plutôt l’apanage des skins des années 80 qui seront plus versés dans le « confrontation dressing », le « prêt à provoquer » issu de l’esthétique punk, plutôt que dans le « dressing smart » des skins des années 60 encore sous l’influence de l’esthétique mod.
Pourquoi en France on n’a pas eu ces sous-cultures ?
Ah ! Grande question ! Il est vrai que l’Angleterre aura vu se succéder sur son sol une grande variété de sous-cultures stylistiques qui plus est, concerneront un très grand nombre de jeunes. Je me rappelle avoir lu à ce propos une enquête réalisée en Angleterre en 2005 où 36% des britanniques déclaraient avoir fait partie, ou faire partie encore, d’une sous-culture. C’est considérable ! Les différents mouvement de modes n’ont pas été la-bas un phénomène marginal comme en France. S’agissant des skins, durant 1968 et 1969, ils se compteront par centaines ne serait-ce que parmi les supporters des clubs de foots du Royaume-Uni. Concernant Manchestrer United, par exemple, ils se compteront par milliers. Dans les années 80, il n’y aura pas seulement des bandes de skins dans chaque ville, mais dans chaque quartier !
Le fait est que les subcultures constitueront la-bas un fait social majeur, qui peut être lié, ainsi que nous l’avons vu, à la destructuration de la classe ouvrière, à un système de classe rigide, au port des uniformes scolaires qui, concernant ces deux derniers aspects, peuvent aussi donner l’envie aux jeunes de se démarquer de la société tout en faisant partie d’une communauté : ainsi par exemple du Japon et de ses multiples courants de mode de rue. Rien de comparable avec la France qui, depuis les Apaches de la Belle Époque, ne se distinguera pas par la formation de sous-cultures autochtones. Quant aux subcultures venues d’outre-Manche qui viendront s’implanter, par effet d’imitation, dans notre pays, elles auront un impact bien moindre compte tenu de la faiblesse du nombre de ses participants. Il n’y aura jamais en France autant de teds, de mods, de skins, de punks… qu’en Angleterre. Pourquoi ? Il y a sûrement des tas de raisons, mais peut-être sommes-nous pas, au fond, un pays particulièrement « rock’n’roll » !
Comment ça ?
Je fais référence à Paul Yonnet qui montre comment « l’idéologie française de la Grande Culture » a conduit à un « rejet primitif » du rock’n’roll dans notre pays [7]. En France, pays de la musique savante et de la chanson à texte, le rock a été moqué et méprisé par beaucoup d’intellectuels et d’artistes. À l’image d’un Boris Vian pour qui Elvis Presley n’était qu’un « illettré », Bill Haley un « mauvais musicien » et le rock qu’un « chant tribal ridicule, à l’usage d’un public idiot ». Le même Boris Vian qui, avec Henri Salvador, enregistrera en 1956 l’un des premiers 45t de rock sur le mode parodique. Je trouve à ce sujet que bien des adaptations françaises de styles musicaux anglo-saxons garderont cette dimension parodique, comme si les groupes eux-mêmes avaient intégré le fait que tout cela n’était pas ici considéré comme sérieux et qu’il fallait jouer d’un second degré.
La France connaîtra son « grand moment rock’n’roll » à l’occasion du concert gratuit organisé par Salut les Copains à Paris le 22 juin 1963 sur la Place de la Nation. Concert qui rassemblera 150 000 personnes occasionnant des incidents grandement amplifiés par les médias qui pointeront du doigt les « blousons noirs » et qui orchestreront une « panique morale ». La scène « yéyé » aura alors tôt fait de prendre ses distances avec les « méchants » blousons noirs incriminés et s’appliquera ensuite à transformer le rock hargneux des débuts en inoffensives chansonnettes. À tel point que la vague yéyé sera favorablement accueillie par l’Espagne de Franco qui n’y verra aucune menace pour les mœurs ou l’ordre public.
Cette « Nuit de la Nation » marquera en France, la prise de conscience de l’existence d’une « culture jeune » à part entière, perçue comme légitime, même si, peut-être toujours au nom de cette « idéologie française de la Grande Culture », elle sera généralement prise de haut. À propos de « culture jeune », contrastant avec les études britanniques qui offriront des études détaillées de leurs différentes subcultures juvéniles locales, ici il ne sera généralement question que des « loubards », terme générique apparu en 1973 et qui, après 1981, sera « utilisé, dans les médias et les ouvrages de sociologie, dans la plupart du temps pour qualifier les jeunes des cités françaises [8] ». Ainsi, l’ouvrage de sociologie Les loubards, une approche anthropologique paru en 1992, utilise ce terme « loubard » de manière générique, pour décrire les bandes de jeunes du début des années 1990, « depuis les blousons noirs jusqu’aux skins et zoulous [9] ».
Revenons aux skinheads. Pourquoi le mouvement Skinhead s’effondre-t-il en 1971 jusqu’à 1977 ?
Après avoir connu son apogée deux ans plus tôt, le mouvement skinhead va en effet perdre de sa vitalité, courant 1971, dans tous les espaces d’émergence qui furent les siens, à commencer par la rue et les stades de football. Répondant à leur réputation de « fauteurs de troubles », la pression policière va s’accentuer envers les skins qui verront se multiplier à leur encontre et en ces lieux les « délits de sale look », ce qui poussera les uns à quitter cette mouvance trop exposée et les autres à se faire plus discrets.
Se voyant confisquer leurs lacets puis leurs chaussures à l’entrée des stades, devant dès lors assister aux matches en chaussettes avec la perspective de devoir ensuite batailler pour récupérer leurs godasses avant que quelqu’un n’ait la bonne idée d’échanger sa paire usée contre une paire neuve, skinheads et autres bootboys, pour éviter ce genre d’embarras, opteront pour le style « casual ». Ce style, baskets et survêtements de marque, toujours connoté mais moins voyant que le style skinhead, leur permettra d’évoluer dans la foule des supporters sans se faire repérer et contrôler par la police.
Dans la rue, un reliquat de skins décideront d’améliorer et de polir leur image, de camper une attitude moins agressive en affichant un style plus fin et plus élégant. Les tenues plus habillées tels que les costumes que mettaient les skinheads pour aller en soirée seront portés usuellement. Les pardessus de style crombie seront très appréciés. Chapeaux melons et fins parapluies noirs pourront même compléter l’ensemble, faisant presque ressembler ces « post-skinheads » à des gentlemen de la City. Les cheveux seront laissés plus long, juste assez pour pouvoir passer un peigne dessus et dégager une raie. Ce léger gain capillaire vaudra à ces « post-skinheads » de se voir qualifier de « suedeheads », les « têtes de velours ».
L’autre élément important, si ce n’est le plus important, ayant conduit au délitement du mouvement skinhead sera l’orientation générale, à cette époque, de la musique jamaïcaine vers les thèmes rastas. Les skins avaient fait des rythmes jamaïcains la bande-son de leur mouvement, mais lorsque le reggae évoluera d’une musique de danse populaire en un moyen d’expression d’une foi mystique, ethnocentrée, ils se sentiront exclus et perdront le contact avec des rude boys devenus rastas. « La négritude toujours plus affirmée du reggae était forcément moins attirante pour les skinheads, qui se sentaient de plus en plus étrangers à cette mouvance musicale, et ce au moment même ou leur propre sous-culture montrait des signes d’essoufflement » écrira Dick Hebdige [10].
Une partie des skins restant vont se greffer à la dynamique scène northern soul qui émergera dans le Nord de l’Angleterre. D’autres, à l’image du groupe Slade qui fut présenté en 1971 comme le premier groupe skinhead, vont évoluer vers le glam rock. Plus rien de spécifiquement skinhead pour un mouvement déjà nettement moins visible et qui, privé de support musical spécifique, se trouve réduit au silence.
Jusqu’à l’explosion du punk en 1977 !
En effet ! À la fin des années 1970, le rock, symbole de la contestation juvénile, semblera s’être assoupi, voire pire, « embourgeoisé ». Les grandes figures de la rébellion, gagnés par l’âge, le succès et la gloire étaient devenus pour la plupart des stars inaccessibles vivant désormais dans un monde de faste et d’opulence bien éloigné de celui de leur public. Déterminé à opérer une nouvelle « révolution de la jeunesse » qui passerait par une urgente et nécessaire « ré-appropriation » de la musique en général afin de revenir à plus d’authenticité, le punk ouvrira une brèche et nombreux seront les groupes qui s’y engouffreront, prenant à leur tour la musique à bras-le-corps, compensant souvent le manque de moyens techniques et financiers par la sincérité et la motivation. Le grand mérite du punk aura été de créer une effervescence musicale qui s’accompagnera d’un réveil et d’un renouvellement des styles et sous-cultures passées. Teddy boys, mods, skinheads vont ainsi connaître une nouvelle dynamique, une nouvelle jeunesse.
Du côté des skins, cette nouvelle dynamique aura pour origine la scène « street punk », une scène qui se définira comme plus brute, plus authentique, plus prolétarienne que le punk « arty » ou « fashion » et qui deviendra le point d’attraction d’un public attiré par ce « style de la rue ». Groupe phare de cette scène, Sham 69 verra, en 1978, se constituer autour de lui une turbulente Sham Army composée de « bald punks », les « punks chauves », qui constitueront le noyau dur d’un renouveau skinhead. « Les skinheads sont de retour » clame alors Jimmy Pursey, chanteur de Sham 69, lors d’un de ses premiers concerts, constatant et déclenchant à la fois un phénomène qu’il aura bien du mal à gérer !
Jimmy Pursey ! Le grand nom des skinheads de l’époque est lancé ! Tu peux le présenter ?
Ah ! C’est un personnage ! Plus qu’à leur musique, un punk bien hargneux, les Sham 69 devront beaucoup de leur notoriété à la personnalité hors norme de leur chanteur. Celui-ci, entre sa vie, son répertoire de chansons à connotation réalistes et sociales et ses énergiques prestations scéniques, ne tardera pas à faire figure de véritable working class hero auprès de ses nombreux fans. Sa jeunesse tumultueuse passée dans les Borstals, les maisons de redressement anglaises, ses rapports conflictuels avec tous ceux qui prétendront avoir autorité sur lui, contribueront à asseoir et à rendre crédible son image de vrai « dur » instruit à « l’école de la rue », sachant et pouvant parler d’expérience de ce que peut être la vie lorsque l’on est issu des « bas quartiers ».
Désireux d’être « la voix » des poor white looser up against the law, Jimmy Pursey se révélera être un show man accompli capable de tenir ce rôle avec conviction. Par la passion et l’intensité qu’il mettra dans l’interprétation de ses chansons, aux thèmes simples mais fédérateurs, tel le fameux « If the kids are united… [11] », il parviendra à transformer chacun de ses concerts en un grand moment de fusion entre lui et son public. La scène étant ouverte à tous, les concerts de Sham 69 prendront rapidement l’allure d’une fête débridée entre « potes ». En ouvrant ensuite les backstages à qui le souhaite, Jimmy Pursey complétera son image d’homme du peuple resté simple et accessible en jouant cette fois le rôle du grand frère attentif avec qui il est toujours possible de discuter. « C’est que Jimmy Pursey prenait très au sérieux l’influence qu’il pouvait exercer sur les "kids" et qu’il pensera sincèrement que SHAM 69 pourrait changer les choses. Pas le monde, il n’était pas aussi naïf, mais peut-être, disait-il, qu’il pourrait au moins intervenir favorablement sur la vie de ceux qui suivaient le groupe assez régulièrement. [12] » Jimmy Pursey, disais-je, aura des difficultés à canaliser l’agitation de ses fans, à commencer par cette nouvelle génération de skins qu’il aura contribué à faire émerger auprès de lui.
Qu’en est-il de cette nouvelle génération de skins par rapport à la précédente ?
La scène street punk va donc occasionner une réapparition des skinheads que la oi !, sous-genre musical issu de cette scène, va ensuite fédérer au cours des années 80. Ce revival skinhead prendra forme dans un contexte bien différent, celui de la crise économique et du chômage, et sera incarné par une nouvelle génération imprégnée de nouvelles références stylistiques et musicales issues du punk. Alors que les premiers skins cultivaient une allure impeccable, le dressing smart et s’enthousiasmaient pour les musiques et les danses chaloupées venues de Jamaïque, cette seconde génération se remarquera par son esthétique plus agressive, le dressing hard, et aura pour goût les sonorités agressives et les danses brutales du punk et de la oi !. Une fierté d’appartenir à la classe ouvrière associée à des formes plus ou moins affirmé de localisme ou de patriotisme en plus d’un penchant affirmé pour la violence formeront tout de même une sorte de fond commun campant une vision partagée de ce mouvement. Mais au début de ce revival, c’est plutôt l’incompréhension qui régnera entre anciens et nouveaux skinheads, entre héritiers des mods et héritiers des punks.
On remarquera au passage que l’histoire du mouvement skinhead est très largement conditionné par la musique : c’est l’évolution du mouvement mod vers la musique psychédélique qui conduira à une scission avec les hard mods. C’est en fréquentant les lieux où se jouait la musique jamaïcaine que les hard mods, en subissant l’influence des rude boys, vont devenir des skinheads. C’est le tournant rasta de la musique jamaïcaine qui réduira le mouvement skinhead au silence. C’est dans le sillage du punk, via la scène street-punk qu’émergera à nouveau le mouvement skinhead et c’est avec la musique oi ! que ce mouvement parviendra à se faire entendre à nouveau.
Le revival ska de 1979 a aussi relancé le mouvement ?
Exact ! Le revival ska porté par la scène 2 tone connaîtra un grand succès au Royaume-Uni et participera aussi de ce fait, en empruntant à la culture skinhead beaucoup de ses références musicales et vestimentaires, à la renaissance de ce mouvement. Le 2 tone permettra aux nouveaux venus de se connecter, à côté ou en dehors du street punket de laoi !, à toute une culture musicale et esthétique qui avait fondé ce mouvement et aux anciens skins de retrouver des sonorités leur étant plus familières que le punk.
À l’origine du 2 tone se trouve Jerry Dammers, claviériste du groupe The Specials, qui aura l’idée d’ajouter au caractère dansant du ska des années 60 l’urgence du punk et la mélodicité de la pop. Avec pour emblème un damier noir et blanc symbolisant l’entente des Noirs et des Blancs réunis par la musique, il créera en 1979 le label 2 tone dont le nom est une allusion, d’une part au style vestimentaire des rude boys basé sur l’association contrastée de deux tons vifs et, d’autre part, au tempo du ska et à son rythme syncopé caractéristique temps/contre-temps. Le terme 2 tone désignera aussi le style musical des formations opérant sous cette étiquette tels The Selecter, The Beat et Madness à ses débuts…
Le 2 tone véhiculera par son rythme et ses paroles un état d’esprit à la fois festif, hérité du ska traditionnel, et revendicatif, issu du punk. Faire « danser et réfléchir les gens dans le même temps [13] », tel sera en effet le credo des Specials en ces années de crise économique, de troubles sociaux et politiques. L’objectif étant d’inviter les jeunes britanniques, et notamment leur public skinhead, à se divertir au son énergique de leur musique tout en leur faisant prendre conscience des injustices sociales et raciales se produisant dans leur pays. Car les Specials comme d’autres groupes de la scène 2 tone, malgré leur composition multiraciale et leur engagement antiraciste revendiqué, seront aussi exposée aux troubles qui agiteront parallèlement la scène street punk et oi ! et devront faire face, certes dans une moindre mesure, à des skinheads manifestant bruyamment, par conviction, par provocation, leur soutien à des partis d’extrême droite. Certains jeunes skins, sans grande cohérence idéologique, pouvant participer à une marche du National Front l’après-midi pour aller danser le soir à un concert des Specials.